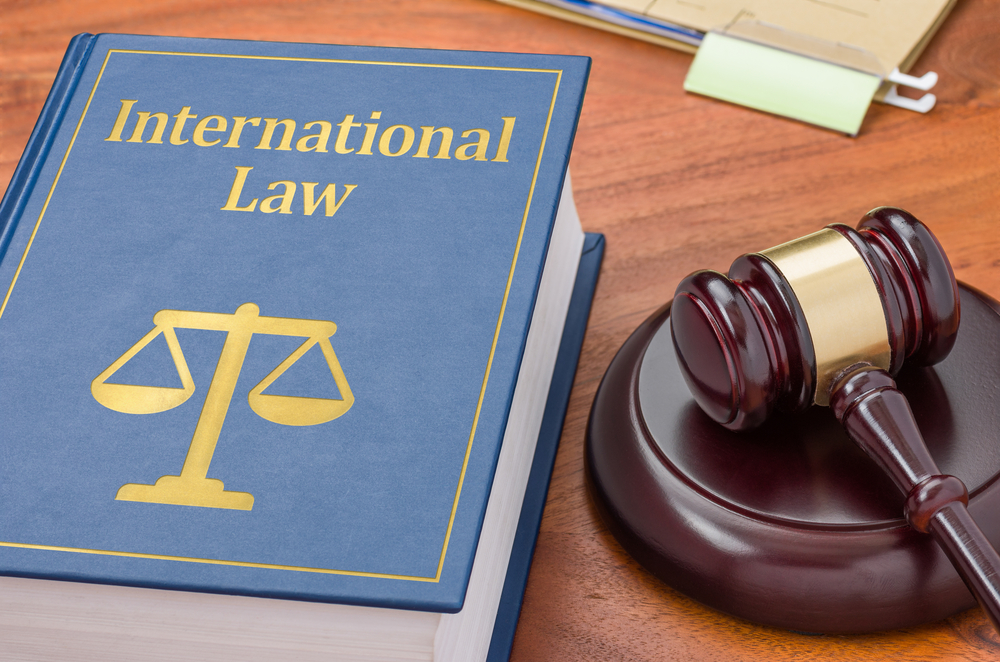INTRODUCTION
Depuis l’utilisation de l’arme nucléaire en 1945, les relations internationales ont été profondément marquées par la nécessité de réguler son usage et d’empêcher sa prolifération.
La puissance destructrice sans précédent de ces armes a conduit les États à mettre en place des accords visant à limiter leur production, leur déploiement et leur usage, tout en tentant de préserver un équilibre stratégique entre les grandes puissances.
Dès les années 1960, alors que de nouvelles nations accèdent à la technologie nucléaire, la communauté internationale met en place des traités destinés à encadrer cette prolifération et à établir des mécanismes de contrôle.
Le poids des traités nucléaires
Certains accords, comme le Traité de non-prolifération (TNP), visent à empêcher la dissémination de l’arme nucléaire, tandis que d’autres, tels que les traités SALT et START, cherchent à limiter le nombre d’armes déployées par les États nucléaires. Parallèlement, des accords comme le Traité de Moscou (1963) ou le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) ont été adoptés pour limiter les essais et les dommages environnementaux associés.
Cependant, si certains de ces traités ont permis de stabiliser temporairement les relations internationales, d’autres ont été abandonnés ou contournés en raison des rivalités géopolitiques et des évolutions technologiques. Ainsi, la question nucléaire demeure un enjeu stratégique majeur, influencé par les tensions entre grandes puissances et les risques liés aux nouveaux acteurs cherchant à se doter de l’arme suprême.
Cet article présente une analyse des principaux traités internationaux ayant trait aux armes nucléaires, en mettant en lumière leurs objectifs, leurs effets et leurs limites.
LES TRAITÉS NUCLÉAIRES
Traité de Moscou (1963) – Interdiction partielle des essais nucléaires

Lien vers le Traité de Moscou.
Contexte
Entre les années 1950 et 1960, les États-Unis et l’URSS réalisent des centaines d’essais nucléaires atmosphériques, ce qui cause une contamination radioactive mondiale (du strontium-90 est même détecté dans le lait maternel).
En outre, à la fin de la crise des missiles de Cuba (en 1962), les grandes puissances ont cherché à enclencher une désescalade.
Contenu
- Les essais souterrains restent autorisés.
- Mais ces essais nucléaires sont interdits dans l’atmosphère, dans l’espace et sous l’eau.
Signataires
125 autres États, dont les USA, l’URSS et le Royaume-Uni.
Limite
La France et la Chine refusent de signer et poursuivent leurs essais atmosphériques jusqu’en 1974 et 1980, respectivement.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) – 1968 (en vigueur depuis 1970)

Lien vers le texte du TNP.
Contexte
Dans les années 1960, plusieurs pays, (dont la France, la Chine, Israël) acquièrent l’arme nucléaire. L’inde s’apprête à développer son programme.
Les Etats-Unis et l’URSS craignent une prolifération incontrôlée.
Contenu
- Une distinction entre les Etats dotés de l’arme nucléaire, et entre les Etats non dotés est créée.
- Les États non dotés s’engagent à ne pas chercher à acquérir l’arme nucléaire.
- Les États dotés promettent de négocier le désarmement (mais sans obligation précise).
- Le nucléaire civil est autorisé, mais sous contrôle de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).
Limites
- Réduit le nombre de pays nucléaires, mais n’empêche pas l’Inde, le Pakistan et Israël d’acquérir l’arme.
- Les grandes puissances ne désarment pas réellement.
- La Corée du Nord signe, puis s’en retire en 2003 avant de se doter de l’arme.
Traité ABM (1972) – Limitation des défenses antimissiles (abandonné en 2002)

Lien vers le texte de l’ABM (en anglais).
Contexte
La doctrine de la dissuasion nucléaire repose sur la capacité des Etats de se détruire mutuellement en cas de conflit nucléaire (destruction mutuelle en français, et Mutual Assured Destruction (abrégée MAD) en anglais. Toutefois, les défenses antimissiles risquent de briser cet équilibre et de relancer la course aux armements. Un bon système de défense permettrait d’intercepter les missiles de l’ennemi.
Contenu
- Les Etats dotés doivent se limiter à ne posséder que deux sites antimissiles maximum (réduit à un seul en 1974), afin d’éviter qu’un pays puisse se sentir invulnérable et lancer une attaque nucléaire en premier.
Limite
Dès 2002, les États-Unis se retirent du traité pour développer leur bouclier antimissile. La Russie réagit en modernisant ses missiles (ex. : missiles hypersoniques Avangard capables de contourner les défenses antimissiles).
Accords SALT I & II (1972-1979) – Limitation des armements stratégiques

Lien vers le texte de l’accord SALT 1.
Lien vers le texte de l’accord SALT 2.
SALT I (1972)
L’accord plafonne le nombre de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et de sous-marins nucléaires. Cet accord ne concerne toutefois pas les ogives multiples (MIRV), qui vont exploser le nombre de têtes nucléaires déployées.
SALT II (1979)
L’accord tente de limiter les MIRV et les nouveaux missiles stratégiques, mais les Etats-Unis refusent de le ratifier après l’invasion soviétique de l’Afghanistan (1979).
Traité INF (1987) – Élimination des missiles nucléaires de portée intermédiaire (500-5 500 km)

Lien vers le texte du traité INF.
Contexte
Dans les années 1980, l’URSS déploie ses missiles SS-20 en Europe de l’Est, créant la crise des « euromissiles ». Leur portée leur permettait d’atteindre des cibles en Europe de l’Ouest, y compris les principales villes et bases militaires des États-Unis en Europe. Le déploiement de missiles nucléaires à portée intermédiaire en Europe a intensifié les craintes d’une guerre nucléaire sur le continent.
Les États-Unis répliquent en positionnant des Pershing II en Allemagne. Une guerre nucléaire opposant les USA et la Russie sur le continent européen est redoutée.
Contenu
Élimination totale des missiles de portée intermédiaire basés au sol en Europe de l’Est, notamment en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l’Est. Destruction de près de 2 700 missiles par les USA et l’URSS. Ce traité met fin à la crise des « euromissiles ».
Limite
Le traité est abandonné en 2019. Les États-Unis se retirent en accusant la Russie de violer le traité avec son missile 9M729. La Russie accuse les USA de vouloir relancer la militarisation.
Accords START I (1991) et START II (1993) – Réduction des armes stratégiques

Texte de l’accord START 1 : Non trouvé. Documentation américaine disponible sur ce lien.
Texte de l’accord START 2 : Non trouvé. Documentation américaine disponible sur ce lien.
Contexte
À la fin de la Guerre froide, les États-Unis et l’URSS possèdent des milliers d’ogives nucléaires stratégiques, ce qui augmente considérablement les risques de destruction mutuelle en cas de conflit direct.
Les négociations débutent en 1982 dans le cadre du processus de réduction des armes stratégiques (Strategic Arms Reduction Talks – START).
L’effondrement de l’URSS en 1991 entraîne des incertitudes sur le contrôle des arsenaux nucléaires soviétiques dispersés dans plusieurs nouveaux États (cf le traité de Budapest en 1994).
Contenu
- START I (1991) :
- Signé par George H.W. Bush et Mikhaïl Gorbatchev.
- Réduction des ogives nucléaires stratégiques déployées à 6 000 par pays.
- Élimination de nombreux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et bombes nucléaires.
- Appliqué également aux anciennes républiques soviétiques (Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan).
- Il marque une avancée majeure dans la réduction des armes stratégiques et établit des mécanismes de vérification rigoureux.
- START II (1993) :
- Signé par George H.W. Bush et Boris Eltsine.
- Vise l’élimination des missiles balistiques intercontinentaux à ogives multiples (MIRV).
- Prévoit une nouvelle réduction des arsenaux à 3 500 ogives maximum.
Limite
- Le START I est appliqué, puis il est remplacé par le SORT (2002), et enfin par le New START (2010).
- Le START II n’entre jamais en vigueur en raison de la détérioration des relations américano-russes. Il a été ratifié par les deux parties mais n’a jamais été appliqué en raison du retrait de la Russie en 2002, qui était une réponse au retrait américain du traité ABM.
Voir aussi le communiqué du ministère français des affaires étrangères, en date du 31 juillet 1991, sur la signature d’un accord START entre les Etats-Unis et l’URSS.
Traité de Budapest (1994)

Lien vers le texte du traité de Budapest.
Contexte
Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, plusieurs des républiques soviétiques nouvellement indépendantes, notamment l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie, se retrouvent avec d’importants arsenaux nucléaires hérités de l’URSS. Cette situation suscite des préoccupations internationales quant à la sécurité des armes nucléaires et à la possibilité de leur prolifération. En 1994, ces pays, cherchent à établir leur souveraineté et à se débarrasser de l’héritage nucléaire, ils participent donc à la négociation du Traité de Budapest. Ce traité vise à sécuriser les armes nucléaires soviétiques tout en garantissant la souveraineté des États concernés par le biais d’accords de sécurité.
Contenu
- Renonciation aux armes nucléaires : L’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie acceptent de renoncer à leur statut d’États nucléaires et de transférer leurs arsenaux nucléaires à la Russie.
- Garanties de sécurité : En échange, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s’engagent à respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté des signataires. Ces garanties visent à rassurer les pays sur leur sécurité face à d’éventuelles menaces.
- Coopération : Le traité encourage également la coopération en matière de non-prolifération nucléaire et de désarmement.
Limites
- Absence de mécanismes contraignants : Le traité ne prévoit pas de mécanismes d’application rigoureux pour garantir que les parties respectent leurs engagements. En cas de violation, il n’existe pas de sanctions claires.
- Contexte géopolitique : Les garanties de sécurité ont été mises à l’épreuve par des événements ultérieurs, notamment les tensions entre la Russie et l’Ukraine, culminant avec l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cela a soulevé des questions sur l’efficacité des garanties promises et a conduit certains pays à remettre en question la crédibilité du traité.
- Impact sur les relations internationales : Le traité n’a pas empêché d’autres États d’acquérir des capacités nucléaires, et les tensions régionales continuent d’influencer les dynamiques de sécurité en Eurasie.
Traité de Pelindaba (1996) – Zone exempte d’armes nucléaires en Afrique

Lien vers le texte du traité de Pelindaba.
Contexte
L’Afrique du Sud développe un programme nucléaire militaire sous l’apartheid, mais décide d’y renoncer en 1991.
L’Organisation de l’unité africaine (OUA) pousse à la création d’une zone dénucléarisée en Afrique pour éviter toute prolifération.
Contenu
- Interdiction pour les signataires de la posséder, développer, du stocker et déployer des armes nucléaires sur le territoire africain.
- Les signataires s’engagent à ne pas stationner d’armes nucléaires étrangères sur leur sol.
- Mise en place d’un mécanisme de vérification avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
- Ce traité renforce la tendance mondiale visant à limiter la prolifération et la présence d’armes nucléaires dans certaines régions du monde.
Limite
Le traité ne prévoit aucune garantie absolue contre des utilisations militaires ou des installations clandestines. Certains pays, comme le Maroc et l’Égypte, ne l’ont pas encore ratifié.
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE, 1996)

Lien vers le texte du TICE.
Contexte
Après des décennies d’essais nucléaires atmosphériques, sous-marins et souterrains, la communauté internationale cherche à bannir définitivement ces essais.
Le traité est négocié sous l’égide des Nations unies pour compléter les précédents accords partiels (comme le traité de Moscou, de 1963).
Contenu
- Interdiction totale de tout essai nucléaire, qu’importe soit sa nature ou le lieu de l’essai.
- Création d’un Système de surveillance international (SSI) comprenant plus de 300 stations détectant toute explosion nucléaire.
- Engagement à ne pas aider ou inciter un autre État à effectuer des essais nucléaires.
Limite
Le traité n’est pas encore entré en vigueur car plusieurs États-clés (USA, Chine, Inde, Pakistan, Iran, Israël, Corée du Nord) ne l’ont pas ratifié. La Corée du Nord a d’ailleurs poursuivi des essais nucléaires en 2006, 2009 et au-delà, mettant en évidence l’absence de contrainte réelle du traité.
SORT (2002) – Réduction des arsenaux stratégiques américains et russes

Lien vers le texte du SORT.
Contexte
Après la fin de la Guerre froide, les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie restent très importants. L’administration de George W. Bush souhaite réduire rapidement ces stocks sans passer par des négociations prolongées.
Le traité est signé en 2002 entre les États-Unis et la Russie.
Contenu
- Réduction du nombre d’ogives nucléaires stratégiques déployées à un maximum de 2 200 pour chaque pays d’ici 2012.
- Flexibilité laissée aux parties pour gérer leur propre arsenal (aucune obligation de destruction des ogives retirées du service).
- Validité jusqu’en 2012, remplacé ensuite par le traité New START.
Limite
Le traité n’impose aucune mesure de vérification stricte de la réduction des stocks. Il ne concerne, en outre, que les ogives déployées, et permet donc de conserver un important stock d’ogives en réserve.
Traité New START (2010, prolongé jusqu’en 2026)

Il remplace à la fois le traité START I (expiré le 5 décembre 2009) et le traité SORT (expiré en 2012) et reprend le fond des traités START des années 1990.
Il limite les arsenaux stratégiques à 1 550 ogives et à 700 vecteurs par pays.
En 2023, la Russie a suspendu sa participation en raison des tensions avec l’OTAN.
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN, 2017)
Lien vers le texte du TIAN.
Ce traité interdit totalement les armes nucléaires : leur possession, leur usage, ou même la menace de leur usage).
Comme l’on peut s’en douter, aucun Etat doté de l’arme nucléaire ne l’a signé. Il est donc purement symbolique. Il est dépourvu d’effet concret sur les arsenaux nucléaires actuels.
CONCLUSION GENERALE

Les traités internationaux sur les armes nucléaires reflètent une tension permanente entre la nécessité de prévenir une catastrophe globale et la volonté des grandes puissances de préserver leurs intérêts stratégiques. Depuis la Guerre froide, ces accords ont contribué à limiter la prolifération et à instaurer un certain cadre de stabilité, mais ils restent fragiles face aux évolutions géopolitiques et technologiques.
Alors que certains traités, comme le Traité de non-prolifération (TNP), ont réussi à limiter l’accès à l’arme nucléaire, d’autres ont été progressivement abandonnés, tels que le Traité ABM ou le Traité INF, relançant les dynamiques d’armement. Les nouvelles menaces, comme le développement des missiles hypersoniques et l’érosion des cadres de contrôle, constituent un grand défi à la régulation actuelle.
Pour aller plus loin
Article du site sur les vecteurs nucléaires.
« La dissuasion nucléaire aujourd’hui« , article de Jessica Cox publié le 08 juin 2020.